
La vie de François Rabelais est pleine d’incertitudes et de rebondissements.
Sa date de naissance, entre 1483 et 1494, est toujours sujette à discussions de même que le lieu de cet événement (probablement dans la campagne chinonaise peut-être dans une demeure familiale à La Devinière dans la paroisse de Seuilly – au sud-ouest de Tour en actuelle Indre-et-Loire). Son père était avocat au siège royal de Chinon, il appartenait donc à une forme bourgeoisie provinciale. On trouve dans Gargantua de nombreuses références à la Touraine (e.g. chapitre V « Oh larmes du Christ ! C’est de la Devinière, c’est du vin pineau » ; chapitre IV « ils convièrent pour ce faire [= manger les tripes des bœufs abattus pour Mardi-Gras] tous les citadins de Cinais, de Seuillé, de La Roche-Clermault, de Vaugaudry, sans oublier Le Coudray, Montpensier, le gué de Vède, et autre voisins, tous bons buveurs, bons compagnons, et tous bons joueurs de quille »).


La première date assurée que nous connaissions de sa vie est celle de son entrée au monastère franciscain de Fontenay-le-Comte, à proximité de Poitier, en 1521. Nous savons par ailleurs, grâce à une lettre qu’il a écrite cette même année à l’humaniste Guillaume Budé, qu’il était alors « adolescens », c’est-à-dire « jeune homme », soit âgé d’une vingtaine d’années (à moins que ce ne soit une formule d’humilité de sa part écrivant à une personne déjà considérée comme un maître de l’humanisme).
Pour la suite de sa carrière, nous avons de la main-même de Rabelais, une « supplique » qu’il a écrite au pape Paul III (1534-1549) afin d’être réintégré dans les privilèges (les « indults ») qui lui avaient été conférés par son engagement religieux mais aussi la reconnaissance de ses diplômes de médecine :
François Rabelais, prêtre du diocèse de Tours, pendant sa jeunesse entra en religion dans l’ordre des Frères mineurs, y fit profession et y reçut les ordres mineurs et majeurs , y compris le presbytérat, et en remplit de nombreuses fois les fonctions. Ensuite, un indult du pape Clément VII, votre prédécesseur immédiat, lui permit de passer dudit ordre des Frères mineurs à celui de Saint-Benoît dans l’église cathédrale de Maillezais, et il demeura dans cet ordre pendant plusieurs années. Par la suite, ayant quitté l’habit religieux, il partit pour Montpellier ; il y fit à la faculté de médecine des études et des leçons publiques pendant plusieurs années, il y prit tous ses grades, y compris celui de docteur, dans la susdite faculté de médecine, et il exerça son art, là et en de nombreux autres endroits, pendant de nombreuses années.
Finalement touché par le repentir, il vint au tombeau de Saint-Pierre à Rome, et de Votre Sainteté et du défunt pape Clément XIII, il obtint l’absolution de son apostasie et de son irrégularité, et la permission de revenir dans l’ordre susdit de Saint-Benoit, où il avait pu trouver des hommes disposés à l’accueillir […]
Les historiens ont permis de remettre des dates sur les éléments donnés par Rabelais, et de vérifier ses affirmations :
- 1521 : entrée au monastère de de Fontenay-le Comte, dans l’ordre des Franciscains (Ordre des Frères Mineurs).
- 1524 : il quitte l’ordre Franciscain parce que ses livres de grec lui ont été retirés parce que leur étude n’était pas conforme à la règle de Saint-François, ni aux instructions de la Sorbonne (l’université de théologie la plus importante de France à l’époque) ; en effet, à l’époque La Bible en usage et qui est la référence absolue est la Vulgate traduite du grec par Saint Jérôme, accéder aux versions antérieures du texte biblique, en grec ou en hébreux, c’est donner la possibilité de questionner le texte ce qui est inconcevable pour les théologiens de la Sorbonne. Le pape Clément VII l’autorise à rejoindre l’abbaye de Maillezais et l’ordre bénédictin dont la règle permet précisément l’étude. C’est à cet ordre qu’appartient Frère Jean des Entommeures, personnage haut en couleurs mais aussi caricature du moine médiéval (ch. 27, 39-45, 52)
- 1530 : il s’inscrit à la faculté de médecine de Montpellier. Il y a fort à parier qu’avant cette arrivée à Montpellier, il ait passé quelques temps à Paris, comme en témoignent les 16 chapitres qui se déroulent dans cette ville dans Pantagruel (l’œuvre qui précède Gargantua) et les quelques épisodes de Gargantua (ch. 16-21). Il y obtient son premier titre universitaire, le baccalauréat.
- 1531 : il se rend à Lyon pour y mener une carrière éditoriale et publie des traductions de textes savants antiques (notamment des médecins), des œuvres d’humanistes contemporains, mais aussi son premier roman, Pantagruel sous le pseudonyme d’Alconfrybas Naser.

- 1532 : Il est nommé médecin à l’Hôtel Dieu de Lyon. Et poursuit ses activités éditoriales
- 1533 : Il est reçu bachelier en médecine à la faculté de Médecine de Montpellier. Seconde édition de Pantagruel qui est censuré par la Sorbonne du fait, entre autres, de l’injonction faite à Pantagruel par son père Gargantua de poursuivre des études humanistes plutôt que celles affirmées par le canon sorbonique (étude scolastique pure). L’ensemble des romans de Rabelais sont du reste systématiquement censurés par la Sorbonne.
- 1534 : Il entre au service de Jean du Bellay, évêque de Paris, et ambassadeur de François Ier, roi de France. Il est l’oncle du poète Joachim du Bellay (1522-1560). Rabelais devient son médecin personnel. Premier séjour à Rome. Jean du Bellay est un catholique modéré, c’est-à-dire que dans l’opposition entre les catholique et les protestants d’une part, et entre les catholiques eux-même d’autre part, il cherche la conciliation et refus les oppositions systématiques.
- 1535 : Publication de Gargantua.
- 1535-1536 : Deuxième séjour à Rome avec Jean du Bellay qui est créé cardinal à cette occasion. Il obtient l’autorisation papale (Paul III) de pratiquer la médecine mais avec interdiction d’employer le fer et le feu (la dissection est contraire à la religion) et obligation de gratuité.
- 1537 : Il est reçu docteur en médecine.
- 1539 : Il entre au service de Guillaume du Bellay, frère aîné de Jean du Bellay, qui est, depuis 1537 vice-roi de France pour le Piémont, région d’Italie nouvellement conquise et rattachée au royaume de France. Rabelais occupe, auprès de lui, les fonctions de médecin et de bibliothécaire. Il reste à son service jusqu’à sa mort en 1543.
- 1546 : Publication du Tiers livre (la continuation de Pantagruel)
- 1547-1549 : Troisième séjour à Rome aux côtés de Jean du Bellay
- 1548 : Publication du Quart livre.
- 1550 : Il accompagne le cardinal Jean du Bellay dans son château de Saint-Maur-des-Fossées (à l’est de Paris).
- 1553 : Il meurt en région parisienne (Meudon ou Paris)
- 1564 : Publication du Cinquiesme livre.
Ce que l’on peut/doit retenir de ces éléments parce que cela a une incidence sur l’écriture de Rabelais et le contenu de Gargantua :
- De son expérience de moine franciscain il retire un certain esprit de dérision et d’irrévérence dont on trouve de très nombreuses traces dans Gargantua (e.g. la harangue de Maître Janotus de Bragmardo au chapitre XIX). Mais il leur reproche aussi une vision trop étroite de la religion et du savoir, cette critique est aussi adressée aux professeurs en Sorbonne (ch. 18, 19, 21)
- De son expérience de moine bénédictin il retire un approfondissement de la connaissance des textes anciens et un développement humaniste plus important. Mais il reproche à la vie monacale son détachement du monde (ce qui est pourtant le principe-même de la vie de moine qui se retire volontairement et à fins contemplatives du monde) ainsi qu’une vie mécanique de la foi (ch. 27).
- En tant qu’humaniste il s’oppose frontalement aux thèses et positions de la Sorbonne. Il peut se le permettre aussi parce qu’il a su s’assurer la protections de puissants (la famille du Bellay en particulier, qui lui permet d’obtenir la permission du roi d’éditer ses livre nonobstant l’opposition sorbonique). Les thèses humanistes sont visibles, en particulier dans l’éducation donnée à Gargantua par Ponocratès (ch. 23-24), mais aussi, dès le prologue, par l’ancrage dans la littérature ancienne du roman.
- Son expérience et son expertise médicale se lit à travers les multiples références médicales et anatomiques que l’on trouve dans Gargantua : qu’il s’agisse de l’éducation dispensée par Ponocrate qui veille à rééquilibrer les humeurs de Gargantua afin de combattre son flegme naturel (ch. 23), de la description de l’accouchement de Gargamelle (ch. 6) ou encore des sévices reçus par les soldats de Picrochole lors du sac de l’abbaye de Seuillé sous les coups de Frère Jean (ch. 27).
- On lit son positionnement de médiateur dans l’ensemble des tentatives de médiation présentes dans le texte, qu’elles soient sincères comme l’ambassade d’Ulrich Gallet auprès de Picrochole (ch. 30) ou parodiques comme celle de Maître Janotus auprès de Gargantua pour récupérer les cloches de Paris (ch. 19).
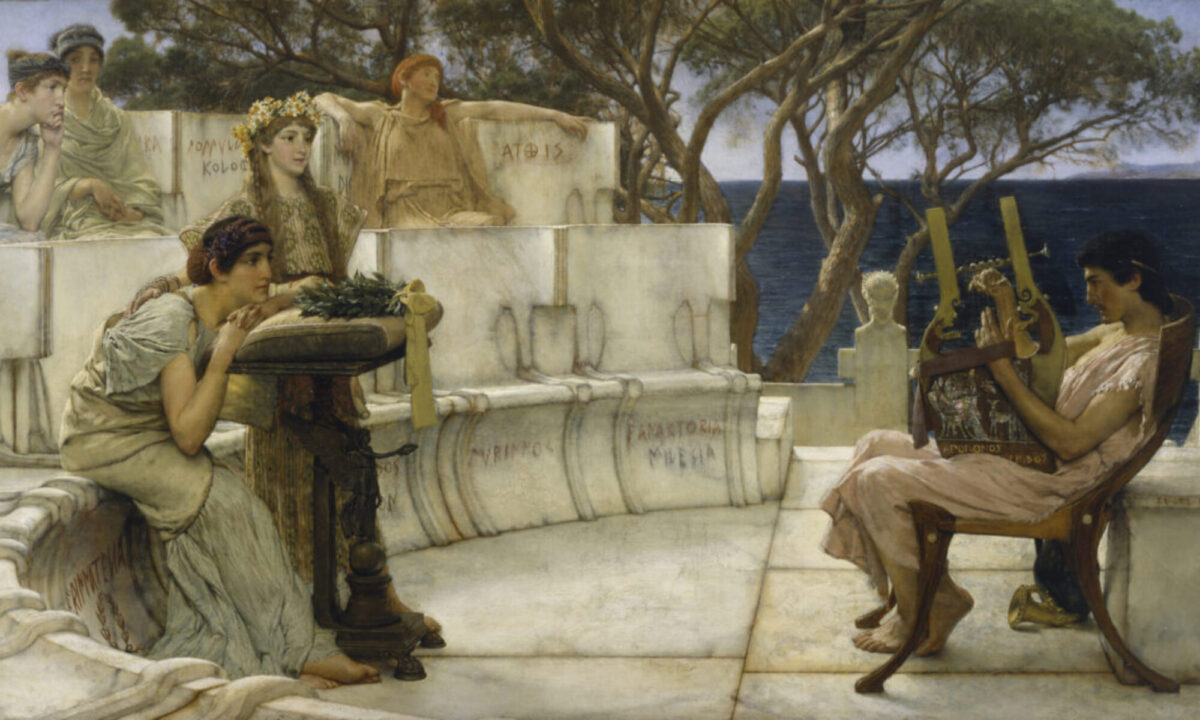
Une réponse sur “Vie de Rabelais”
Les commentaires sont fermés.