Les Essais de Montaigne sont une œuvre composée durant 18 ans et inachevée à la mort de l’auteur en ce sens que l’édition que nous lisons est celle qui inclut les notes manuscrites que Montaigne a apporté à la troisième édition de son texte en 1588, c’est ce que l’on appelle « l’exemplaire de Bordeaux » (parce qu’il est conservé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux).

L’édition des Essais s’est donc déroulée en quatre temps :
1580 : Première édition. Le texte comporte alors deux livres qui comportent, en tout, 94 chapitres (57 pour le Livre I et 37 pour le Livre II). Cette première édition devait, dans l’esprit de Montaigne, au début de son projet éditorial, servir d’écrin au Traité de la servitude volontaire de La Boétie, mort en 1563. Le texte de son ami aurait dû venir s’intercaler entre le premier et le second livre. Ce projet n’a jamais vu le jour.
1587 : Deuxième édition du texte qui comporte environ 150 corrections mineures et 50 ajouts conséquents, souvent inspirés de ses voyages en Italie dans les années 1580-1581.
1588 : Troisième édition. Le texte des deux premiers livres est très largement remanié par l’ajout de nombreux passages (plus de 500 peut-on lire sur le privilège royal). L’autre nouveauté de cette édition est l’addition d’un troisième livre composé de 17 chapitres dont le volume est aussi important que chacun des deux autres livres.

Cette troisième édition se justifie de deux façons : l’une littéraire, l’autre économique.
Du point de vue littéraire, Montaigne n’a jamais cessé de retravailler, de remanier, d’approfondir son propos. Les additions de la troisième éditions sont les marques de cette réflexion en mouvement.
Du point de vue économique, les livres imprimés en France, le sont majoritairement avec un « privilège ». Il s’agit d’une autorisation exclusive octroyée à un éditeur d’imprimer un texte, pour une durée limitée (ici neuf ans). A la fin de la période déterminée par le privilège, tout éditeur peut imprimer, pour son compte, le texte, il échappe donc à son auteur. La solution pour proroger un privilège est de soumettre une œuvre passablement remodelée. C’est ce que note le privilège du roi reproduit ci-dessus :
Par grâce et privilège du Roi, il est permis à Abel L’Angelier, libraire […] d’imprimer […] Les Essais du Seigneur de Montagne revus et amplifiés de cinq cents passages, avec l’augmentation d’un troisième livre, et sont faites très expresses défenses à tout imprimeur et libraire d’imprimer ledit livre jusques au temps et terme de neuf ans, sur peine de confiscation des livres qui se trouveront imprimés, et d’amende arbitraire […]
1592 : Édition de l’Exemplaire de Bordeaux par Marie de Gournay qu’il nomme sa « fille d’alliance » (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de lien de parenté entre eux mais qui lui reconnait une forme de filiation par l’affection et l’intérêt intellectuel qu’ils se portent) :
« J’ai pris plaisir à faire connaître à plusieurs endroits les espoirs que me donne Marie de Gournay le Jars, ‘ma fille d’alliance’, et assurément aimée de moi plus que paternellement et entourée d’affection, dans ma retraite et ma solitude, comme si elle était l’une des meilleures partie de mon être propre » (« De la présomption », II, 17)
C’est à elle que l’épouse de Montaigne envoie l’exemplaire annoté afin qu’elle le publie. C’est cette édition (revue et corrigée par des scientifiques modernes) que nous lisons.
Pour faire la différence entre ces trois états du texte, une convention veut que l’on mette en évidence chacune d’entre elles dans le texte. Ainsi, dans l’édition que nous lisons, le texte de la première édition est marquée avec un trait oblique ( / ), celui de la troisième édition avec deux traits obliques ( // ) et celui de l’édition de Bordeaux avec trois traits obliques ( /// ).
Cela n’a, en soi, pas d’incidence sur notre lecture du texte. En revanche, cela en a une pour comprendre que l’écriture de Montaigne, reflet de sa pensée, est en perpétuel mouvement et qu’il procède par approfondissements successifs. Ces approfondissements s’apparentent, parfois, à des digressions – changements apparents de sujet avant d’y revenir. On le voit par exemple dans des formules comme celle que nous avons rencontré au début « Des Cannibales » : « or je trouve, pour revenir à notre propos, que… » (l. 120).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, compléter ces éléments en écoutant l’émission suivante :
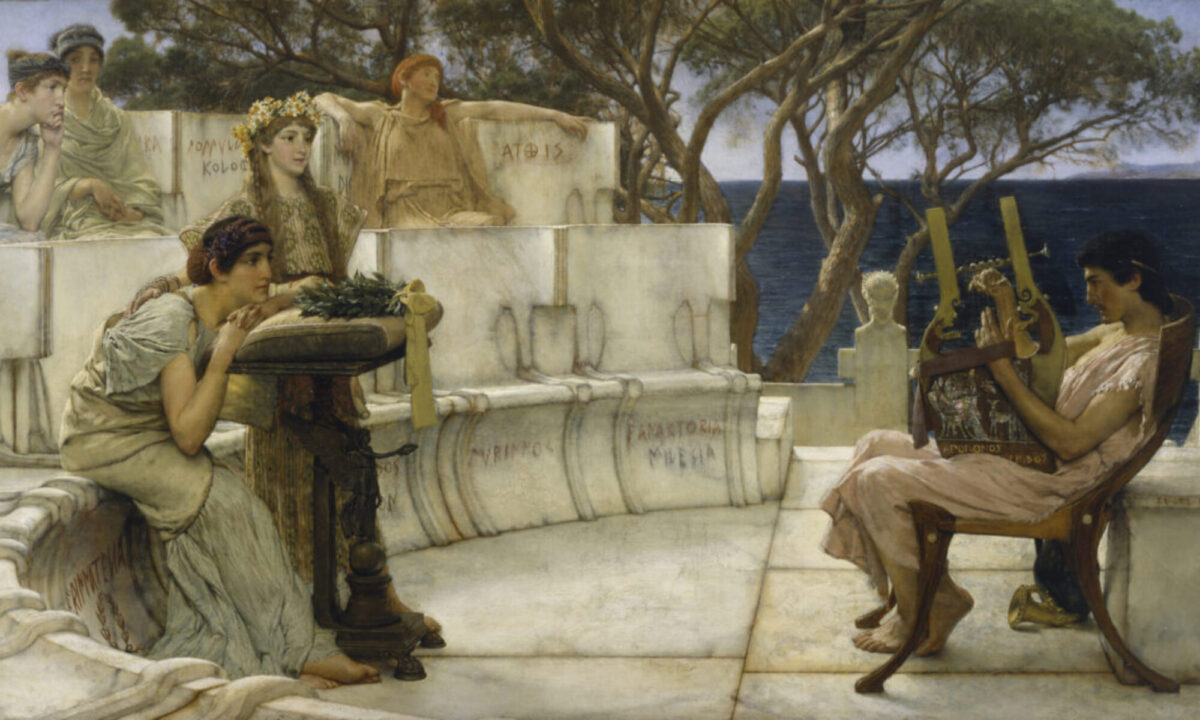
2 réponses sur “Montaigne, Les Essais (1595) – Une brève histoire du texte.”
Les commentaires sont fermés.